Antony Cordier est un cinéaste talentueux et rare. Depuis Douches froides, son premier long métrage en 2005, il a signé Happy Few (2010), Gaspard va au mariage (2017) et réalisé les deux saisons de la série Ovni(s) (2021-2022). De retour sur le grand écran avec Classe moyenne, il adapte avec Julie Peyr un scénario original de Jean-Alain Laban et Steven Mitz.
Comédie caustique sur fond de lutte des classes, le film regroupe sept personnages dans la résidence secondaire cossue de Parisiens fortunés. Entre les propriétaires, Philippe (Laurent Lafitte) et Laurence (Élodie Bouchez), et les gardiens de la villa, Nadine (Laure Calamy) et Tony (Ramzy Bedia), la cohabitation vire rapidement à la guerre de tranchées. Menacés de licenciement, les concierges montrent les dents et fomentent la contre-attaque.
Au milieu de la zone de combat, Mehdi (Sami Outalbali), le petit ami de Garance (Noée Abita), la fille du couple, cherche à déminer le conflit, surfant sur son extraction modeste. Avec sa mécanique humoristique implacable faite de bons mots et de gags volontiers cruels, Classe moyenne s’amuse des travers de ses personnages sans hésiter à pousser le bouchon un peu loin.
Vous aviez déjà abordé dans vos premiers films, le documentaire Beau comme un camion et Douches froides, la question de classe. Qu’est-ce qui vous a poussé à y revenir de manière si frontale ?
Antony Cordier
Beau comme un camion était un film autobiographique, sur ma trajectoire de transfuge de classe et le fait d’être le premier travailleur intellectuel au sein d’une famille de manuels. Mon premier film de fiction, Douches froides, plutôt réaliste, assez naturaliste, abordait aussi cette question de classe. Je n’y serais pas forcément revenu de moi-même. Aborder cette question sous l’angle de la satire me permettait de renouer avec la comédie italienne des années 1960-1970 qui, adolescent, a représenté pour moi une forme d’idéal.
J’ai aussi beaucoup aimé la comédie française dans les années 1970-1980. Beaucoup moins après, lorsqu’elle a quitté les rives de l’observation sociale. On avait Viens chez moi, j’habite chez une copine, Les Bronzés ou Marche à l’ombre, des comédies très populaires, ouvertes, accessibles, avec des personnages qui bossent, galèrent, cherchent des emplois, habitent des squats. Dans les années 1990, quand Les Nuls ou Les Robins des Bois sont arrivés, les comédies ont eu le goût de l’absurde, plutôt inspiré par les Monty Python. Cette possibilité de faire un film populaire et, en même temps, féroce et méchant, m’a excité.
Mais ce film arrive aussi à un moment où les contestations sociales sont nombreuses…
Oui, le projet me paraissait actuel. Il traite aussi du fossé qui s’élargit entre deux classes opposées, détestées ou pointées du doigt à tort ou à raison, entre en gros, les ultra-riches et ceux que la droite appelle les assistés. Ces gens sont systématiquement désignés comme étant le cœur du problème. Ces deux catégories ne peuvent plus se parler en raison d’une situation politique polarisée.
Il y a aussi la question centrale de l’argent. Le film traite de gens très fortunés qui emploient des gens au noir. On peut se demander pourquoi, puisqu’ils ont les moyens de les déclarer.
Garance (Noée Abita), Nadine (Laure Calamy) et Tony (Ramzy Bedia), les concierges de la villa dans le film.
© Tandem Films
En nous documentant pour la réécriture du scénario, avec Julie Peyr, nous nous sommes aperçus que des tas de personnes très riches le faisaient. Inès de La Fressange et Denis Olivennes se sont retrouvés au tribunal parce qu’ils avaient une employée non déclarée. Francis Ford Coppola s’est comporté de manière odieuse avec des employés philippins non déclarés qui s’occupaient de son appartement à Paris. Cette passion pour l’exploitation des gens, alors qu’on a les moyens financiers de faire autrement, est assez fascinante et mystérieuse.
Peut-être se sentent-ils intouchables ?
Évidemment, ils n’ont pas peur de la police. Dans une scène avec Garance (comédienne en devenir) et Mehdi, elle arrive à forcer les portes d’un casting en mentant sur sa situation familiale. C’est une jeune fille pleine de charme, très séduisante et blanche. Elle sait qu’elle ne risque rien. Même si Mehdi arrive à changer de classe sociale, il n’aura jamais cette forme d’aisance, cette absence de peur et ce capital culturel.
Quels sont les parallèles entre le parcours de Mehdi, jeune homme issu d’un milieu modeste devenu avocat, et le vôtre ?
J’ai la chance d’appartenir à deux mondes. Mais j’ai quitté la classe populaire. J’ai grandi avec une forme d’injonction de mes parents qui ne voulaient pas que je fasse comme eux. C’est une parole très étrange quand elle vient de personnes qu’on aime et qu’on admire. J’ai fait en sorte de ne plus appartenir à cette classe populaire tout en l’adorant et en me sentant plus à l’aise avec elle qu’avec les autres. Cette schizophrénie et cette culpabilité liées à la trahison sont présentes chez Mehdi et chez moi.
Comment vous sentez-vous dans ce milieu du cinéma ?
Si je me retourne sur mon parcours, j’ai eu beaucoup de chance. Néanmoins, je manquais de bagage pour savoir comment naviguer dans cette industrie. Je suis absolument nul en réseautage et je me suis lié avec des gens comme moi. Je vois des camarades réalisateurs ou réalisatrices extrêmement habiles qui savent comment se comporter pour être protégés, bien traités par la presse, invités dans les festivals, les jurys et faire des films plus souvent. C’est un savoir-faire social que je n’ai pas. Il n’y a pas de cours de réseau à la Fémis.
Comment expliquez-vous votre rareté sur le grand écran ?
J’essaie toujours de monter des films que l’industrie ne veut pas produire. Si j’ai accepté Classe moyenne, c’est aussi parce que j’essayais de monter un film qui se passait dans les années 1970, autour des corps, du désir, de la révolution des mœurs, voire de la concupiscence dans ces années-là. Ce n’était pas du tout sulfureux mais les productions et les distributeurs sont tous terrorisés. Ils me disaient : « Je l’aurais fait il y a deux ans mais aujourd’hui je ne sais pas quel scud je vais me prendre dans la tête. »
Les films que je veux faire sont un peu problématiques et je n’arrive pas à les monter. L’industrie me place à des endroits où j’ai le droit d’être, sur des projets parfois en panne ou des séries à rendre réalisables comme Ovni(s). Je me bats pour monter mes films et en même temps, parfois, je vais là où on me dit d’aller.
Classe moyenne, d’Antony Cordier, France, 1 h 35, en salle le 24 septembre 2025.
[SRC] https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/cinema-francais/classe-moyenne-dantony-cordier-cette-passion-pour-lexploitation-des-gens-alors-quon-a-les-moyens-de-faire-autrement-est-assez-fa
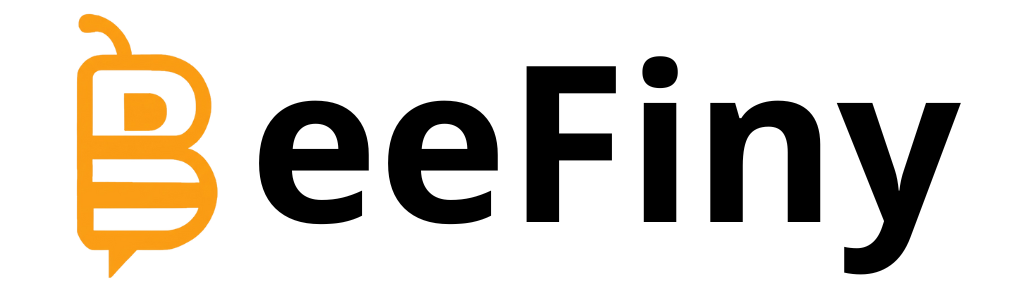 Visit the website
Visit the website
