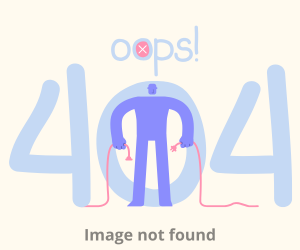Des publications enthousiastes annoncent la fin du franc CFA, symbole d’un héritage jugé encombrant. Pourtant, derrière la ferveur numérique, la réalité est tout autre : aucune nouvelle devise n’a encore été lancée, aucun billet n’a été imprimé. L’annonce qui a enflammé les discussions est née à Bamako, lors de la visite du président nigérien Abdouramane Tiani, où fut évoquée la création prochaine d’une banque confédérale du Sahel.
L’idée, ambitieuse et hautement symbolique, s’inscrit dans une volonté de souveraineté monétaire partagée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette banque confédérale serait le socle d’un futur système financier propre à l’AES, destiné à financer les projets de développement, réduire la dépendance à l’extérieur et, à terme, envisager une monnaie commune. Sur le plan politique, l’initiative traduit une dynamique d’intégration et d’affirmation régionale. Sur le plan économique, elle ouvre un champ d’interrogations techniques et institutionnelles d’une rare complexité.
Créer une banque confédérale ne relève pas d’un simple geste politique. C’est une entreprise structurelle qui exige la mise en place d’un cadre juridique harmonisé, d’une gouvernance crédible et d’une discipline financière partagée. Il faudrait d’abord instaurer une banque centrale confédérale, dotée d’un mandat clair de stabilité monétaire et disposant de réserves de change solides. Or, les pays de l’AES présentent aujourd’hui des économies fragiles : peu diversifiées, dépendantes des importations et des cours mondiaux de l’or ou du coton, avec des réserves en devises limitées à quelques mois d’importations. Ces fragilités réduisent la marge de manœuvre pour soutenir une nouvelle monnaie ou maintenir un taux de change stable.
Le franc CFA, malgré les critiques qu’il suscite, offre à ses membres une garantie de convertibilité assurée par le Trésor français, ainsi qu’une relative stabilité des prix. En sortir, c’est aussi renoncer à cet ancrage et à la sécurité qu’il procure. Une monnaie confédérale du Sahel, non adossée à une devise forte, serait exposée à des risques de dépréciation et d’inflation. Les importations (carburant, denrées alimentaires, médicaments) deviendraient plus coûteuses, affectant directement le pouvoir d’achat des populations.
À cela s’ajoutent des défis institutionnels. Une monnaie commune suppose une coordination budgétaire étroite et une transparence rigoureuse dans la gestion des finances publiques. Sans discipline commune, la tentation de financer les déficits par la création monétaire serait grande, au risque d’alimenter l’inflation et d’éroder la confiance. La future Banque confédérale devrait donc être indépendante du pouvoir politique, avec un mandat centré sur la stabilité et la crédibilité plutôt que sur le financement des dépenses publiques.
Quelles idées pour réussir ?
Pour réussir, la transition devrait être progressive. Il serait nécessaire d’abord de renforcer les fondamentaux économiques : accroître les réserves de change, stabiliser les budgets, harmoniser les politiques fiscales et développer des outils de suivi macroéconomique communs. Un ancrage temporaire à une monnaie internationale euro, dollar ou yuan, pourrait aussi contribuer à éviter une volatilité excessive au démarrage.
Mais au-delà des calculs économiques, la démarche porte une dimension symbolique forte. Elle traduit la volonté des pays de l’AES de prendre en main leur destin et de repenser leur modèle de coopération, après des décennies d’intégration au sein de l’UEMOA. Elle s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique mouvant, marqué par la redéfinition des alliances, la montée des partenariats avec la Russie, la Chine ou les BRICS, et la volonté d’affirmer une voie sahélienne de développement.
Pour autant, l’expérience internationale montre que la souveraineté monétaire ne se décrète pas : elle se construit. La Guinée, dès 1960, fut la première à quitter la zone CFA. Son expérience fut marquée par une inflation rapide et un isolement financier. À l’inverse, des pays comme la Mauritanie ou le Cap-Vert ont réussi leur transition, mais au prix de longues années de rigueur budgétaire, de réformes institutionnelles et de dialogue avec les partenaires économiques.
Les États du Sahel ont donc devant eux une tâche délicate : affirmer leur autonomie sans compromettre leur stabilité. Le projet de Banque confédérale, s’il est conduit avec méthode et réalisme, pourrait devenir un instrument d’intégration et de crédibilité régionale. Mais une précipitation, motivée davantage par l’enthousiasme politique que par la préparation technique, risquerait d’avoir l’effet inverse.
La monnaie, disait un économiste, n’est pas seulement une question de chiffres : c’est une question de confiance. Et la confiance, elle, ne se fabrique pas dans les discours, mais dans la cohérence des politiques publiques. La souveraineté monétaire n’est donc pas une fin en soi, mais le résultat d’une stabilité économique conquise pas à pas.
Dans une vision optimiste, l’on peut dire que l’AES n’a pas encore quitté la zone franc, mais qu’elle aurait engagé un mouvement plus profond : celui d’une réflexion sur l’avenir économique du Sahel. Cependant, comme le ferait tout bon coureur qui veut atteindre à la ligne d’arrivée, se préparer par la lucidité en prenant en compte ses lacunes et faiblesses, est un grand pas vers la réussite.
Ahmed M. Thiam
[SRC] https://www.maliweb.net/economie/nouvelle-monnaie-pour-laes-entre-ambition-souveraine-et-incertitudes-economiques-3109984-3109984.html
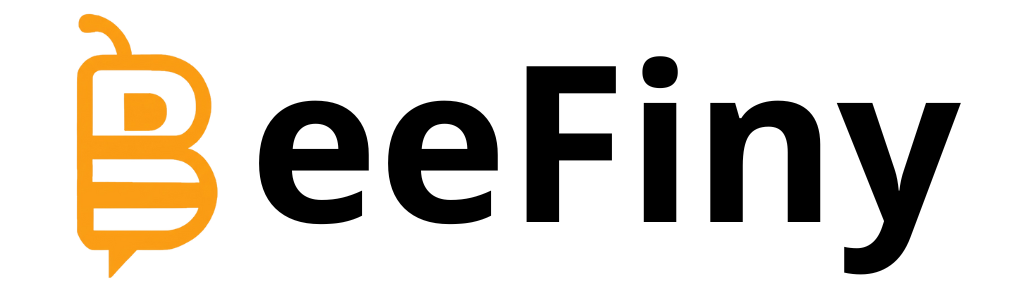 Visit the website
Visit the website