Agrandir l’image : Illustration 1 Agrandissement : Illustration 1 Fermer
Ricardo Martins
Le Moyen-Orient et l’Asie du Sud se retrouvent à nouveau au cœur d’une profonde transformation géopolitique. Le 17 septembre 2025, l’Arabie saoudite et le Pakistan ont signé à Riyad l’Accord stratégique de défense mutuelle (SMDA).
Le pacte, qui stipule que « toute agression contre l’un des pays sera considérée comme une agression contre les deux », étend en pratique le parapluie nucléaire pakistanais à l’Arabie saoudite.
Signé quelques jours seulement après les frappes israéliennes sur Doha, cet accord a suscité de nombreuses spéculations sur la perte éventuelle par les États-Unis de leur rôle traditionnel de garant de la sécurité du Golfe et sur l’émergence d’un nouvel ordre marqué par des alignements multipolaires.
Avant le pacte : le choc de Doha
Le catalyseur de ce pacte fut l’attaque israélienne du 9 septembre à Doha, visant à éliminer des négociateurs du Hamas. Le Qatar, partenaire historique des États-Unis et hôte d’une importante base militaire américaine, s’attendait à être protégé par son allié. Or, Washington est resté étrangement silencieux et, selon certains analystes, a même joué un rôle actif en faveur d’Israël en assurant le ravitaillement en vol de ses avions de combat.
Comme le note Taut Bataut dans Arab States Reconsider U.S. Alliance After Israeli Strikes on Doha (23 septembre 2025, NEO-Journal), le système de défense aérienne américain est resté inactif pendant le bombardement, révélant la « nature sélective » des garanties de sécurité américaines. Le message aux capitales du Golfe était clair : la protection américaine est conditionnelle et, surtout, subordonnée aux intérêts israéliens.
La réponse dépend autant de la perception que de la substance militaire. Pendant des décennies, les États du Golfe ont cru que la présence de bases américaines équivalait à une protection garantie. Les événements de septembre 2025 ont brisé cette illusion
Ce sentiment de trahison s’est largement diffusé. Un sommet à Doha a réuni 70 pays musulmans, dont les membres de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tous condamnant les actions d’Israël.
Patricia Lalonde, du think tank français Geopragma, a souligné que la présence du Pakistan — « qui possède la bombe » — était particulièrement significative, car elle illustre le basculement vers des alternatives musulmanes aux cadres de sécurité américains.
Le contenu du pacte : ambiguïté nucléaire et profondeur stratégique
Le pacte saoudo-pakistanais frappe par son symbole autant que par son contenu. Bien que le texte complet n’ait pas été rendu public, les responsables ont confirmé qu’il inclut des garanties nucléaires. Ali Shihabi, analyste saoudien proche de la cour royale, a déclaré au Le Monde (22 septembre 2025) que « la dimension nucléaire est intégrale à l’accord », rappelant le soutien financier passé de Riyad au programme nucléaire pakistanais. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a confirmé que le royaume pourrait compter sur la dissuasion nucléaire d’Islamabad si nécessaire.
Ce développement renforce non seulement la posture défensive de l’Arabie saoudite, mais consolide également le rôle régional du Pakistan.
Comme le souligne Rushali Saha dans The Diplomat (22 septembre 2025), si Riyad restera prudent pour ne pas s’impliquer directement dans les conflits indo-pakistanais, le pacte isole néanmoins stratégiquement l’Inde, surtout après que Washington a révoqué sa dérogation aux sanctions sur le projet du port de Chabahar en Iran.
Répercussions immédiates : la confiance ébranlée
La conséquence immédiate de l’attaque de Doha fut une érosion dramatique de la confiance dans les garanties de sécurité américaines. Les États arabes, qui considéraient autrefois l’Iran comme la menace principale, perçoivent désormais Israël comme un acteur imprévisible et potentiellement déstabilisateur.
Les monarchies du Golfe, longtemps dépendantes des États-Unis pour leur sécurité, ont découvert avec stupeur que les bases américaines n’offraient aucune protection contre les frappes israéliennes.
Pour l’Arabie saoudite, le choc est particulièrement fort. Le prince héritier Mohammed ben Salmane, jadis central dans les accords d’Abraham, a durci son discours, dénonçant les actions israéliennes à Gaza comme un génocide. La reconnaissance d’Israël par Riyad semble désormais improbable. Le royaume se tourne plutôt vers des partenariats de défense qui contournent Washington.
Évolutions à moyen et long terme : la multipolarité en marche
À moyen et long terme, le pacte pourrait accélérer le réordonnancement multipolaire de la région. Des analystes allemands, dans Architects of a New Order (IPS, 22 septembre 2025), le qualifient de « bombe géopolitique », inclinant la balance loin d’une « Pax Americana » centrée sur les États-Unis vers des « structures autonomes et multipolaires ».
En choisissant le Pakistan comme partenaire, l’Arabie saoudite gagne également un accès indirect à la Chine. Comme le note Abdus Sabur, le Pakistan sert de « pont stratégique » entre Riyad et Pékin. Avec plus de 70 % de ses armes fournies par la Chine, le soutien financier saoudien pourrait canaliser le capital du Golfe vers l’industrie de défense chinoise, renforçant ce lien triangulaire.
Pour Washington, les dommages à long terme sont évidents. Le pacte montre non seulement que ses bases ne garantissent plus la souveraineté des États hôtes, mais ouvre aussi la possibilité d’alignements arabes avec la Russie ou la Chine. Taut Bataut conclut que « l’alliance des nations arabes avec la Russie, la Chine ou d’autres puissances émergentes accélérera encore le déclin de l’hégémonie américaine ».
Gagnants et perdants
Le pacte saoudo-pakistanais reconfigure les alignements régionaux et globaux, produisant des gagnants et des perdants. On peut résumer ainsi :
Gagnants :
Arabie saoudite : obtient une dissuasion crédible face aux frappes israéliennes et, via le Pakistan, diversifie son autonomie vis-à-vis des États-Unis.
Pakistan : sécurise aide financière, prestige et possibilité de soutien saoudien contre l’Inde.
Qatar : devient un point de ralliement pour la solidarité musulmane après l’attaque de Doha.
Chine : profite indirectement en approfondissant ses liens avec Riyad et Islamabad, renforçant son rôle comme garant alternatif de sécurité et canalisant le capital du Golfe vers ses secteurs de défense et d’énergie.
Russie : bénéficie de l’érosion de l’hégémonie américaine, ouvrant des opportunités pour la vente d’armes, la coordination énergétique et le positionnement diplomatique.
Iran : accueille favorablement le recul américain, tout en surveillant prudemment le rôle du Pakistan.
Perdants :
États-Unis : souffrent d’une crise de crédibilité, leurs bases ne garantissant plus la sécurité.
Israël : fait face à une isolation croissante, même l’Égypte et la Turquie coordonnent désormais militairement contre lui.
Inde : voit sa marge de manœuvre diplomatique réduite, le pacte compliquant son équilibre dans le Golfe et le Pakistan plus fort.
Union européenne : marginalisée, incapable de prévenir l’instabilité régionale croissante.
D’autres États du Golfe, comme les Émirats, Oman, Bahreïn ou le Koweït, se retrouvent dans une position plus ambiguë. Certains étaient signataires des accords d’Abraham, mais l’attaque de Doha les oblige à reconsidérer les coûts d’un alignement avec Israël au détriment de la solidarité intra-arabe.
Conclusion : un véritable changement de jeu ?
Le pacte saoudo-pakistanais est-il un véritable game changer ? La réponse dépend autant de la perception que de la substance militaire. Pendant des décennies, les États du Golfe ont cru que la présence de bases américaines équivalait à une protection garantie.
Les événements de septembre 2025 ont brisé cette illusion. Comme le note Le Monde, le pacte « bouleverse les équilibres régionaux » en démontrant que « les bases américaines au Moyen-Orient ne représentent pas une garantie de sécurité pour le pays hôte ».
Cela ne signifie pas la fin de la puissance américaine dans la région. Washington conserve une capacité militaire incomparable. Mais le pacte signale que les monarchies du Golfe ne sont plus prêtes à confier leur survie uniquement à la bonne volonté américaine.
L’émergence d’un axe saoudo-pakistanais, avec la Chine et la Russie en arrière-plan, marque l’ouverture d’un nouveau chapitre : un chapitre où la multipolarité, et non la singularité américaine, définit la sécurité au Moyen-Orient.
Pour Israël, c’est un avertissement. Pour les États-Unis, un signal d’alarme. Pour l’Arabie saoudite et le Pakistan, c’est l’affirmation que des alternatives existent et que l’architecture de sécurité régionale se réinvente.
[SRC] https://blogs.mediapart.fr/ricardo-martins/blog/300925/attaque-doha-pacte-saoudo-pakistanais-repenser-securite-et-alliances-regionales
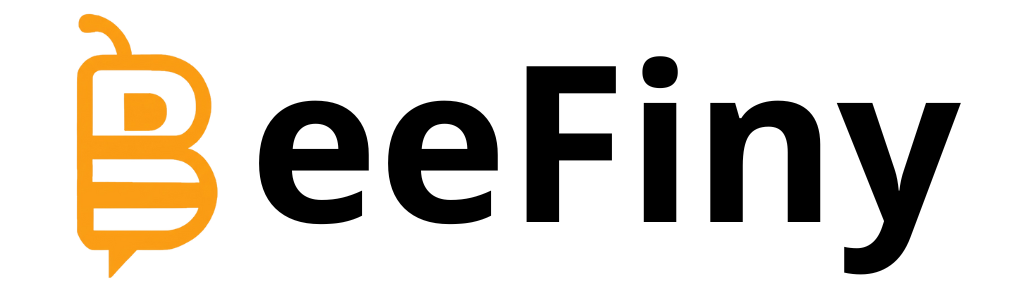 Visit the website
Visit the website







